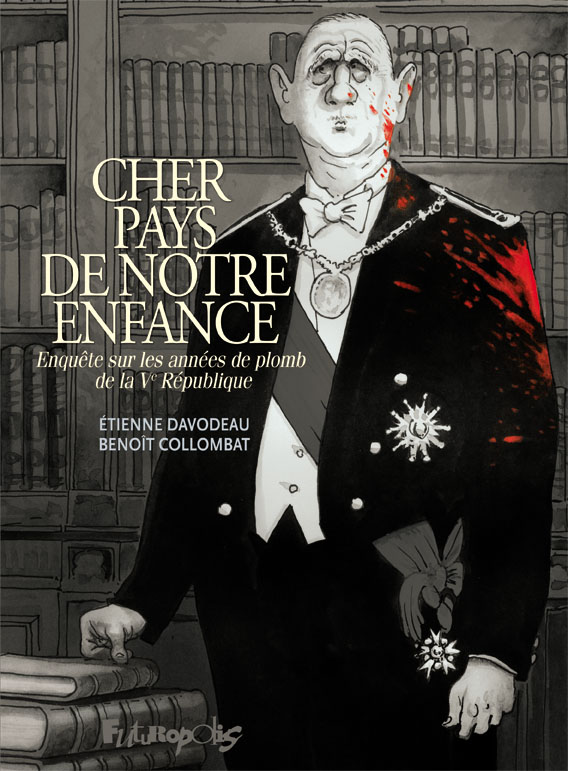Présentation de l'éditeur. « Pourquoi les sociétés modernes ont-elles décidé de sacrifier les paysans ? Qui est responsable de ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter de répondre à ces questions fondamentales, ce livre montre comment, depuis des décennies, en France comme ailleurs, le productivisme s’est étendu à l’ensemble des activités humaines. Avec pour conséquences : déracinement et marchandisation, exploitation du travail et des ressources naturelles, artificialisation et numérisation de la vie. L’époque est aujourd’hui aux fermes-usines et aux usines que l’on ferme ou délocalise, tandis que dominent, partout, finance et technoscience.
Le sacrifice des paysans est l’un des éléments du processus global de transformation sociale dont il faut, au préalable, comprendre les causes. Ainsi, les auteurs analysent le mouvement historique au sein duquel s’est déployé le projet productiviste au cours des 70 dernières années, des « Trente Glorieuses aux Quarante Honteuses ». Puis ils expliquent comment le long travail d’« ensauvagement des paysans » a mené à la destruction des sociétés paysannes et des cultures rurales.
De ce véritable ethnocide, qui a empêché l’alternative au capitalisme
dont une partie des paysans était porteuse, nous n’avons pas fini, tous,
de payer le prix ».
Les auteurs
Yves Dupont a été chercheur à l’INRA (1975-1990). Il a ensuite enseigné la socioanthropologie à l’université de Caen (1991-2006). Depuis 2006, il est professeur émérite et membre du conseil scientifique du Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie génétique (CRIIGEN)
Pierre Bitoun a cosigné avec Yves Dupont et Pierre Alphandéry, Les Champs du départ (La Découverte, 1989) et L’Équivoque écologique (La Découverte, 1991). Il est également l’auteur de Campagnes d’enfance (Cénomane, 2005).
Leur travail permet de les compter parmi les spécialistes du monde rural.
Pourquoi aborder la question paysanne ?
L’objectif du Sacrifice des paysans n’est d’être seulement une analyse sur la disparition de la paysannerie. Les auteurs insistent bien évidemment sur la fonte de cette population. En 1950, en France, il y avait plus de 7,5 millions de paysans, soit un tiers de la population active. On dénombre environ 800 000 agriculteurs aujourd’hui, exploitant un demi-million d’exploitations, autant qu’il en est disparu depuis 2010) ; ils ne représentent cependant plus que 3 % de la population active. Toutefois, l’exemple de la France n’est pas exceptionnel : les autres pays occidentaux connaissent le même phénomène.
Les auteurs se proposent donc de l’étudier, mais en croisant plusieurs facteurs, sociaux, culturels, politiques, etc. Ils sont ensuite partis de l’hypothèse selon laquelle l’analyse de la question paysanne, aussi intéressante soit-elle elle-même, permet surtout d’être un révélateur de la modernité. Autrement dit, leur problématique de savoir en quoi une société se reconnaît-elle comme moderne au travers du sacrifice qu’elle fait de sa paysannerie ?
Un ethnocide
Le terme, présent en quatrième de couverture, peut paraître exagéré. Les auteurs rappellent qu’il se rapporte à la destruction d’un groupe social (ici, la paysannerie, composée en réalité d’une multitude de paysanneries) mais aussi de sa culture. À leur place triomphe l’uniformisation des paysages, de la société.
En remontant dans le passé, Pierre Bitoun et Yves Dupont considèrent l’expérience des camps d’extermination pour montrer que cette logique productiviste était déjà à l’œuvre. On le voit d’ailleurs bien exprimée dans le roman de Robert Merle, La Mort est mon métier. Le caractère mortifère, but du programme d’extermination, éclaire ce qui se passe aujourd’hui. L’analogie permet de comprendre de cette façon les suicides de paysans, tant en France qu’ailleurs (en Inde). Il s’agit de l’une des stratégies utilisées pour hâter la disparition du monde paysan, en opérant un tri. Paradoxalement, les victimes sont précisément ceux qui font les efforts les plus importants pour intégrer le monde moderne : pour produire davantage, ils ont contractés des emprunts. Mais pour les rembourser, il leur faut produire davantage encore, et les voici broyés dans un mécanisme qu’ils ne maîtrisent pas.
Autre paradoxe, ceux-là ont abandonné le qualificatif de « paysan » au profit de celui d’« agriculteur », jugé plus noble. Ce recouvrement est en effet un autre moyen, à l’œuvre depuis longtemps, de l’ethnocide. Il tient à la construction d’une perception péjorative des paysans, un « ensauvagement » qui a conduit à la destruction des sociétés et des cultures rurales, marginalisées. Les paysans apparaissent comme un « brouillon d’humanité», base d’un discours destiné à produire un sentiment de honte. Les auteurs rapproche ce phénomène de la façon dont on a considéré les indigènes des colonies, pour mieux les acculturer, ce qui était une façon de les faire disparaître.
Le monde paysan, porteur de tous les archaïsmes possibles, ne pouvait être que supprimé sur l’autel de la modernité.
Un monde paysan à détruire
L’étude porte sur le monde rural depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les auteurs y voient l’amorce d’un point d’inflexion : s’il n’est pas le premier, il a été décisif, tant ses effets portent encore aujourd’hui.
Le productivisme, qui caractérise l’agriculture actuelle, embrasse en réalité bon nombre d’autres domaines. L’homme est ainsi vu comme une simple ressource humaine1 , par exemple. Dominé par l’économie, il n’en est plus qu’un élément au même titre que les matières premières qu’il travaille ou les machines qu’il manipule, qu’on peut déplacer au gré des besoins économiques. Les auteurs établissent à cette occasion une proximité avec l’idée du déracinement, propre au monde paysan, mais que l’on retrouve également dans la mobilité et la « flexibilité » exigées de bien d’autres catégories de salariés. Ils y voient le triomphe d’une technocratie, à l’image de l’actuel gouvernement mis en place en mai-juin 2017, qualifié de « gouvernement d’experts ». Ce déracinement s’accompagne de la marchandisation, de l’artificialisation, notamment de la production : que ce soit celle des animaux ou des végétaux, le « hors-sol » permet de s’affranchir de l’élément fondamental qu’est la terre.
Un sacrifice en deux temps
Dans un premier temps, les « Trente Glorieuses » préparent le terrain au néo-libéralisme, qui se développe au cours des « Quarante Honteuses » (lesquelles se prolongent…). P. Bitoun et Y. Dupont rapportent les propos des responsables du Commissariat au Plan, qui imposent leurs vues aux gouvernements qui se succèdent, alors qu’ils représentent un élément de stabilité. On voit aussi le rôle très important joué par la FNSEA (fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) et de ses annexes (CNJA, etc.), tant dans l’émergence de la Politique agricole commune que dans l’orientation des subventions européennes. La centrale pratique délibérément la cogestion, au niveau national et supra-national. Elle n’hésite à user de la violence, comme moyen de pression sur les pouvoirs publics, avec l’avantage de rassembler ses adhérents autour de l’idée fictive d’une unité du monde agricole. Rien d’original à cela : les premières organisations recouraient déjà à ce stratagème, porté au plus haut point par la Corporation paysanne de Vichy.
Une agriculture industrialisée apparaît, fermement productiviste et hautement capitaliste. Les auteurs notent d’ailleurs que sa montée en puissance se fait dans le même temps que progresse l’État social, avant que les néo-libéraux en entreprennent une destruction qui se poursuit aujourd’hui.
Un ordre néo-libéral se met en place, qui repose sur l’idée d’une prééminence de l’économie sur l’homme, laquelle entraîne celle du progrès identifié aux seuls aspects techniques (la mesure de la performance passe d’abord par là). Il repose également sur l’idée d’une démocratie accaparée par une oligarchie, sous couvert de technicité : le fameux « gouvernement d’experts » en est une bonne expression.
Le monde rural apparaît comme totalement déboussolé : le sens de son activité s’est perdu, ce qui en fait une proie de choix pour le FN. Les suffrages qu’il rassemble doit être compris comme l’expression d’une revanche sociale. La disparition de la paysannerie pose donc des questions démocratiques.
Comment sortir de l’impasse ?
Les auteurs estiment que l’une des voies possibles est de retrouver l’un des éléments qui caractérise la paysannerie, à savoir ce qui fait société, le commun, pour mieux lutter contre l’individualisme. Ils prennent la précaution d’affirmer qu’il faut se déprendre de l’idée d’une paysannerie bornée à son coin de terroir ; au contraire, il y a lieu d’associer le local et l’universel.
Ils expriment une certaine méfiance à l’égard du discours agro-écologique en vogue, portée par des gens comme Pierre Rabhi. C’est qu’il en appelle à une prise de conscience individuelle, alors que les auteurs préconisent un effort collectif comme la lutte que mène la Confédération paysanne. Une organisation internationale comme Via Campesina à laquelle appartient la Confédération paysanne) rassemble 200 millions de paysans dans le monde entier. Cela permet de mieux percevoir les enjeux collectifs [« la singularité et la force de la Confédération paysanne résident essentiellement dans la capacité de ses membres non seulement à ne pas vivre les situations qui leur étaient faites comme des épreuves personnelles, mais à les transformer en enjeux collectifs de structure sociale »], et d’apporter une solution qui repose sur la solidarité (notamment Nord-Sud), le respect de la nature (travailler avec elle, et non contre elle), la lutte contre l’emprise des multinationales (fauchage des OGM…). Le projet est donc résolument humaniste.
Les auteurs observent avec satisfaction que les valeurs de la Confédération paysanne progresse dans la société, notamment avec les idées de la recherche d’une société post-productiviste, post-capitaliste, de la solidarité, du pluralisme (face à l’hégémonie de la FNSEA), de la désobéissance (avec le démontage du MacDo de Millau ou la lutte contre les OGM). Mais ces valeurs restent cependant encore trop marginalisées.
Pourquoi s’acharner à faire disparaître la paysannerie ?
Les auteurs identifient sept raisons pour expliquer l’élimination du paysan. Parmi celles-là, retenons le lien avec la matière organique, fondamentalement contraire aux conceptions hygiénistes, aseptisées qui caractérisent le monde moderne. C’est aussi le lien avec le sol, qui exprime un lien social et naturel, alors que le nomadisme moderne ne prospère que sur l’artificiel. Enfin, le paysan est l’expression de l’autonomie : il privilégie la valeur d’usage contre la valeur d’échange (c’est-à-dire le capital).
Notes
- 1. À ce propos, on lira avec beaucoup d’intérêt, en pages 99-100, un article paru dans Le Monde : Jean-Pierre Dautun, « Comment je suis devenu une ressource humaine », 13 mars 1993.