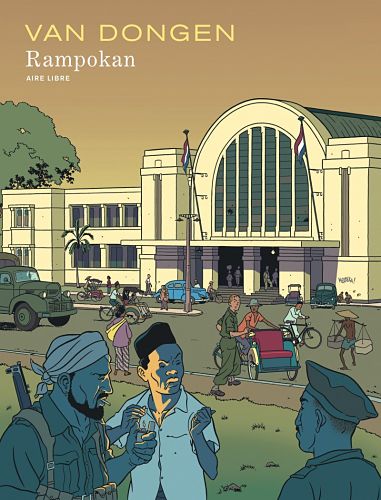Présentation de l’éditeur.
« COMPRENDRE CE QUI NOUS ARRIVE. Avec la force d’une analyse toujours
très argumentée et documentée, le célèbre linguiste américain Noam
Chomsky s’exprime sur les mécanismes de concentration des richesses,
avec une lucidité contagieuse. Il expose clairement les principes qui
nous ont amenés à des inégalités sans précédent, retraçant un
demi-siècle de politiques conçues pour favoriser les plus riches. Une boite à outils pour comprendre le Pouvoir et gagner beaucoup de temps ».
Le sous-titre de ce nouveau DVD édité par Les Mutins (disponible également en VOD et en téléchargement sur leur site)
est plus révélateur du contenu du film que le titre ne le laisse
paraître. Bien sûr, il est question des États-Unis, mais on peut tirer
de l’entretien avec Noam Chomsky des enseignements valables pour la
France et bien d’autres pays.
On ne fera pas
l’injure de rappeler qui est Noam Chomsky, éminent linguiste américain
au MIT, et militant de très longue date. Pour ceux qui n’en savent rien,
ou pas grand chose, et ceux qui voudraient en savoir davantage, on se
reportera à ses écrits mais aussi aux productions des Mutins. Le présent
film donne d’ailleurs quelques-unes de ses interventions publiques dans
les années 1960. Autrement dit, son expérience (avec son lot d’erreurs)
donne suffisamment de crédit à l’analyse qu’il délivre ici, qui rejoint
en cela bien d’autres auteurs.
Le film est très
didactique, s’organisant sur la base de dix principes, qui conduisent à
comprendre « les principes de la concentration de la richesse et du
pouvoir ». En se basant sur l’exemple des États-Unis, Noam Chomsky
démontre en quoi les concepteurs du projet politique américain a, dès
l’origine, cherché à limiter fortement la démocratie : en se méfiant du
peuple, le pouvoir ne devait revenir qu’aux meilleurs, seuls aptes à
comprendre et à agir dans l’intérêt de tous, d’où le choix d’un système
basé sur la représentation par des élus, et non par les citoyens
eux-mêmes. L’alliance entre le pouvoir politique et la richesse a de
même tout de suite été conclue, engageant un cercle vicieux : pour être
élu, il faut avoir de l’argent ; en se tournant vers les entreprises,
l’élu ne pourra pas faire moins que les favoriser, etc.
Il a fallu
attendre les années soixante pour voir s’organiser des franges de la
population qui étaient jusque là passives, et voir progresser les
« droits des minorités, ceux des femmes, la défense de l’environnement,
le combat contre la violence, l’empathie pour les autres ». Mais s’est
ensuivi une forte réaction consécutive des possédants et des
conservateurs pour ne pas perdre leurs positions. Le mémorandum de Lewis Powell
(août 1971) a alerté sur les dangers de cette situation : le monde des
affaires risquait de perdre le contrôle de la société, notamment de la
jeunesse qu’il faut reprendre en main (par le biais d’un contrôle des
universités et des écoles) et de l’opinion publique (par la télévision
et toutes les formes de communication). Pour Powell, l’« homme oublié »
qu’est l’entreprise (voir la recension du très libéral The Fortoggen Man, publiée ici)
exige qu’on lui redonne toute sa place et toute son influence, en
utilisant tous les moyens : information, tribunaux, lobbies, etc. Il a
donc été fait appel aux entreprises (les plus importantes) pour contrer
et attaquer l’approfondissement de la démocratie. L’une des armes a été
constituée par la Commission trilatérale, rassemblant des dirigeants et
des intellectuels occidentaux (dont le sociologue français Michel
Crozier, Samuel Huntington, etc.), qui a notamment publié The Crisis of Democracy
(1975), qui s’émeut d’un « excès de démocratie » et des droits concédés
aux « intérêts spéciaux » (entendez la majorité de la population, mais
considérée comme autant de groupes sociaux qui ont obtenu une
amélioration de leur sort). L’endoctrinement des jeunes est
particulièrement jugé préoccupant : ils doivent être contenus.
La réaction
s’engage également sur le terrain économique (principe 3. « Redessiner
l’économie »), en donnant un rôle plus important aux institutions
financières (banques, assurances, fonds de pension…). De fait, le
résultat est aujourd’hui une « financiarisation de l’économie », les
gestionnaires issus des grandes écoles de commerce ayant remplacé les
ingénieurs à la tête des entreprises, dont l’objet est d’abord de
satisfaire les actionnaires quel que soit le type de production. C’est à
ce moment-là qu’il est mis fin à la séparation entre banques
d’investissement et banques commerciales. La dérégulation débouche sur
une instabilité : les crises se succèdent les unes aux autres, alors que
le phénomène avait disparu entre les années quarante et soixante-dix.
La mondialisation des échanges et le libre-échange sans contrôle a fait
le reste : le capital doit circuler, principe qui ne vaut pas pour les
hommes (sauf pour les élites). Les conséquences sociales ont été
désastreuses, avec une mise en concurrence des salariés, toujours plus
exploités.
À cela, on a
ajouté un « déplacement du fardeau » (principe 4). Dans les années
fastes et stables, les bénéfices étaient fortement imposés, ce qui a
permis de développer un État-providence, et en particulier les
conditions sanitaires, l’éducation, etc. La reprises en main amorcée
dans les années soixante-dix y a mis fin. Les entreprises ont réussi à
obtenir que « les charges » financières soient allégées en leur faveur,
de façon à libérer l’investissement, avec ou sans contrepartie sur
l’emploi. Aujourd’hui, des firmes comme Apple ne sont imposées qu’à
hauteur de 8 %. En revanche, l’impôt a été aggravé pour le reste de la
population, quelle qu’en soit la forme. Les services publics se sont
dégradés. L’accès à l’université s’est ainsi fermé : dans
l’après-guerre, les GI’s démobilisés ont pu bénéficier de bourses
d’étude ; aujourd’hui, il faut s’endetter lourdement pour étudier, ce
qui place les étudiants dans une situation de précarité et de dépendance
à l’égard de leurs créanciers.
Dans le même
temps, on s’en en pris à la solidarité (principe 5). La méthode est
simple : alourdir les contributions et amoindrir les prestations. De
cette façon, on a obtenu une insatisfaction de la population, laquelle
s’est tourné vers des assurances privées. À la solidarité du groupe
s’est substitué un système basé sur l’individu, seul face aux risques.
On a également
assisté à un renforcement des intérêts économiques (le « marché ») pour
mieux contrôler les législateurs (principe 6), par l’intermédiaire des
groupes de pression (les « lobbies »). Le moment a été donné par
l’adoption de mesures progressistes par l’administration Nixon, en
faveur des consommateurs et des salariés, et également de
l’environnement ; Chomsky considère que ce républicain a été le dernier
président du New Deal. À partir de là, les lobbies n’ont eu de cesse que
d’obtenir une dérégulation. Au mépris des principes du libéralisme,
pourtant défendu par les entreprises, le gouvernement est constamment
intervenu pour renflouer les pertes des sociétés en difficulté, ce qui
est une perversion du système capitaliste. Autrement dit, le
contribuable a été appelé au secours de ceux qui ont pris des risques
inconsidérés et garantir les profits de ceux qui cherchent à échapper à
l’impôt. Bien évidemment, l’endettement excessif des particuliers n’est
pas pris en charge par les pouvoirs publics : il y a donc une double
mesure.
Le principe 7
concerne la manipulation des élections. On a dit que la collusion entre
les élus et les groupes économiques qui finançaient leurs campagnes
électorales. Un degré a été franchi dans les années 1970, quand les
entreprises ont obtenu un droit d’expression équivalent à celui des
particuliers. cela s’est traduit par une absence de plafond pour le
financement politique, entendu comme un moyen d’expression comme un
autre. Sauf qu’il s’agit alors de défendre l’intérêt particulier face à
l’intérêt commun. On peut donc facilement prédire qui pourra être le
prochain président : celui qui aura obtenu davantage de dons que ses
concurrents. Cela s’est vérifié lors des dernières élections
présidentielles. Clinton avait reçu le plus de don ; si elle n’a pas été
élue, en raison de l’archaïsme du système électoral américain, elle a
tout de même eu deux millions de suffrages de plus que Trump. Plus
encore, on voit que de grands groupes financent les uns et les autres,
certains de s’y retrouver par la suite : il s’agit d’un investissement
toujours rentable. L’électorat n’est pas dupe, ce qui explique la
faiblesse de la participation aux élections. Il faut y voir aussi
l’effet de la « maîtrise de la populace » (principe 8). Pour cela, il a
fallu s’employer dès les années 1920 à détruire le syndicalisme, force
démocratique importante contre les excès des entreprises. Il a cependant
pu renaître à partir de 1935, mais la contre-offensive s’est vite fait
ressentir, avec la loi Taft-Hardley (1947) qui limite les actions
syndicales, et le développement du maccarthysme. Un sentiment
anti-syndical a pu alors se diffuser dans la population : aujourd’hui, 7
% des employés privés sont syndiqués (comme en France). En même temps,
on s’est acharné à sortir l’idée même d’une lutte des classes de
l’esprit des Américains, en cherchant à « modeler le consentement »
(principe 9). On s’est peu à peu rendu compte que la violence ne pouvait
être un moyen efficace pour façonner les croyances et les comportements
de l’opinion publique, et que des moyens plus subtils se révélaient
beaucoup plus efficaces comme la consommation, comme l’ont très tôt
montré Thorstein Veblen, Walter Lippmann ou Edward Bernays (non cité
dans le film). Le consommateur ne s’intéresse alors plus qu’à la
superficialité des choses, enfermé dans des émotions et mu par elles
sous l’effet de la publicité et des moyens de communication (télévision
ou Internet). Le but est donc de favoriser des comportements
irrationnels, sans aucune réflexion critique : l’électeur pourra voter
contre ses propres intérêts.
De proche en
proche, cet électeur ne sera même plus nécessaire. Peu importe même
qu’il en soit conscient : 70 % de la population américaine estime
qu’elle n’a aucune influence sur la définition des politiques publiques.
On en arrive alors au principe 10 : « marginaliser la population ».
L’effet recherché est un rejet des institutions, contre lesquelles
l’opinion publique exprimera sa colère, sans aucune conscience d’une
auto-destruction. Il suffira alors de gérer ces émotions populaires, la
passivité ayant été obtenue. Pire encore : dans ce développement de
tensions sociales, on aura réussi à introduire l’idée de ne rien faire
pour les autres et l’illusion que la solution est dans les propres
capacités individuelles.
En conclusion,
Chomsky ne cède pas au pessimisme. Il rappelle que John Dewey pensait
qu’il ne peut y avoir de démocratie forte tant que les institutions de
production, de commerce et les médias ne seront pas sous un contrôle
participatif et démocratique. Il faut démanteler les formes d’autorité
qui ne peuvent pas se justifier. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’y a
eu de progrès obtenu sans une forte mobilisation populaire : les droits
n’ont pu été arrachés en établissant un rapport de force, au risque de
la violence. Or, nous sommes dans des sociétés libres : il est possible
de manifester, de réclamer, de se défendre. Noam Chomsky termine en
évoquant Howard Zinn, autre grand intellectuel et militant dont on s’est fait l’écho à plusieurs reprises sur ce site :
« Seules importent les innombrables petites actions des inconnus qui
sont à la base des événements les plus significatifs de l’Histoire ».
Il y a ici des
leçons à tirer pour tout enseignant, et d’abord en tant que citoyen : ce
film agit en tant qu’éveilleur de conscience. Le contexte de l’élection en 2017
(et de sa réélection en 2022) en France d’un président dont on sait qu’il a bénéficié des moyens
financiers les plus importants, d’une dégradation de la participation
électorale, de la défiance à l’égard des institutions, de la crise dite
des « gilets jaunes », de sa répression, de la réclamation d’une
démocratie directe qui puisse permettre aux citoyens de jouer leur rôle,
tout cela tombe à point nommé pour qu’on prête à ce Déclin du rêve américain toute l’attention qu’il mérite d’avoir.