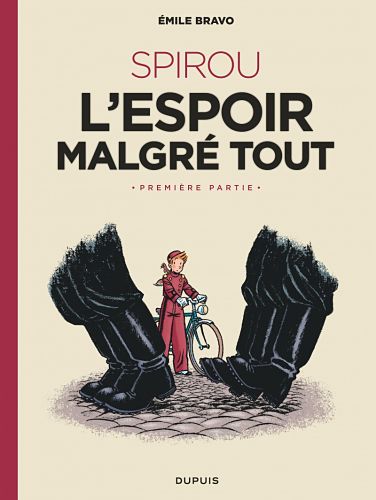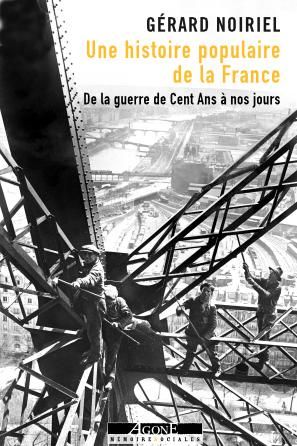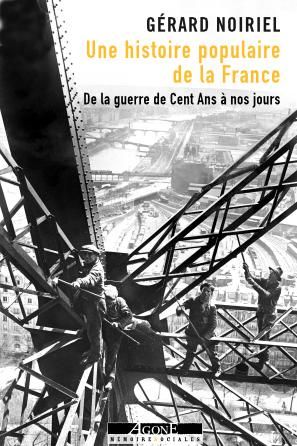
La France, c’est ici l’ensemble des territoires
(colonies comprises) qui ont été placés, à un moment ou un autre, sous
la coupe de l’État français. Dans cette somme, l’auteur a voulu éclairer
la place et le rôle du peuple dans tous les grands événements et les
grandes luttes qui ont scandé son histoire depuis la fin du Moyen Âge :
les guerres, l’affirmation de l’État, les révoltes et les révolutions,
les mutations économiques et les crises, l’esclavage et la colonisation,
les migrations, les questions sociale et nationale.
Extraits de l’introduction. «
L’ambition ultime de cette Histoire populaire de la France est d’aider
les lecteurs non seulement à penser par eux-mêmes, mais à se rendre
étrangers à eux-mêmes, car c’est le meilleur moyen de ne pas se laisser
enfermer dans les logiques identitaires. »
« La démarche
historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels
nous sommes confrontés aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, dans
cette histoire populaire de la France, j’ai privilégié les questions qui
sont au centre de notre actualité, comme les transformations du
travail, les migrations, la protection sociale, la crise des partis
politiques, le déclin du mouvement ouvrier, la montée des revendications
identitaires. Le but étant de mettre cette vaste réflexion à la
disposition du plus large public, j’ai adopté la forme du récit en
m’efforçant de présenter sous une forme simple des questions parfois
très compliquées. »
« Pour moi, le “populaire” ne se confond pas
avec les “classes populaires”. L’identité collective des classes
populaires a été en partie fabriquée par les dominants et, inversement,
les formes de résistance développées au cours du temps par “ceux d’en
bas” ont joué un rôle majeur dans les bouleversements de notre histoire
commune. Cette perspective m’a conduit à débuter cette histoire de
France à la fin du Moyen Âge, c’est-à-dire au moment où l’État
monarchique s’est imposé. Appréhendé sous cet angle, le “peuple
français” désigne l’ensemble des individus qui ont été liés entre eux
parce qu’ils ont été placés sous la dépendance de ce pouvoir souverain,
d’abord comme sujets puis comme citoyens. »
« Ce qui permet
d’affirmer le caractère « populaire » de l’histoire de France, c’est le
lien social, c’est-à-dire les relations qui se sont nouées au cours du
temps entre des millions d’individus assujettis à un même État depuis le
XV e siècle, et grâce auxquelles a pu se construire un « nous »
Français. Les classes supérieures et moyennes ont été dans l’obligation
de tenir compte des activités, des points de vue, des initiatives, des
résistances, propres aux classes populaires, afin de mettre en œuvre des
formes de développement autres que celles qu’elles avaient imaginées au
départ. Et réciproquement, les représentations du peuple français que
les élites ont construites au cours du temps, les politiques qu’elles
ont conduites, ont profondément affecté l’identité, les projets, les
rêves et les cauchemars des individus appartenant aux classes
populaires ».