Pascal Rabaté, La Déconfiture, seconde partie, Futuropolis, 8 février 2018, 120 p., 20 €. ISBN : 9782754823128
Présentation de l’auteur. « Juin 1940. Videgrain, soldat du 11e régiment, est sur les routes…
Les Allemands ont enfoncé tous les fronts, c’est la débâcle. Les Stukas
viennent faire des incursions meurtrières sur les colonnes de réfugiés
qui fuient l’avancée allemande. Videgrain, qui a été séparé de son
régiment, le rejoint à temps pour être fait prisonnier par l’armée
allemande avec tous ses camarades. Au fil du chemin qui les emmène vers
leur camp de détention,
leur nombre s’accroît de jour en jour, confirmant l’étendue de la
défaite française. Videgrain, son copain Marty et quelques autres
soldats, veulent profiter de la pagaille créée par cette colonne de
prisonniers qui s’étire de plus en plus, pour s’évader…
Juin 1940. C’est la débâcle de l’armée française et l’exode pour de nombreux civils. À travers le destin d’un simple bidasse, Rabaté signe, 18 ans après Ibicus, un grand récit en deux parties sur une période trouble où tous les repères quotidiens ont sauté… ».
Je n’ai pas encore pu lire la première partie de La Déconfiture,
paru en août 2016 . Un bien, un mal ? Je ne le saurai qu’au moment
d’avoir le volume entre les mains. Dans celui-ci on suit Amédée
Videgrain, dans une colonne de prisonniers qui se dirige vers
l’Allemagne, comme un mille-pattes, une chenille qui grossit au fur et à
mesure de sa progression, sans qu’il y ait « de chances qu’elle
devienne papillon » (p. 8). Par un dessin au trait noir fin, Pascal
Rabaté propose trois plans d’approche : les prisonniers,
principalement ; leurs gardiens allemands, à distance ; les civils.
Des premiers, il nous donne à entendre les préoccupations, la première
tenant à l’alimentation. Il nous livre aussi leurs interrogations sur
leur projection dans des événements qui dépassent leur entendement.
Ainsi ce comptable qui n’est jamais sorti de Loche, qui remplissait sa
vie « de petits riens » ; « et puis patatras… V’là tout ça qui me me
tombe sur la gueule, ma vie toute remplie d’un coup par un truc trop
grand pour moi » (p. 9). Ce sont aussi les rumeurs qui circulent, et qui
ont prise sur les hommes désorientés et isolés : « il paraît qu’ils
tirent sur les fuyards » ; « il paraît que l’armée avait de bons
stratèges » (p. 17-18). Et la hiérarchie qui se reforme : « Debout, il
faut reprendre la route ! Ordre des Allemands » […]. « Il n’aura pas
fallu longtemps à certains pour trouver de nouveaux maîtres » ; « Je ne
fais qu’obéir aux ordres » ; « C’est ça, oui : t’es un bon chien » (p.
27).
Mais ce sont aussi les travers humains qui réapparaissent, pour peu
qu’ils aient réellement disparus. L’échelle du grenier dans lequel on a
trouvé refuge (p. 48), qu’on a soigneusement enlevée ; les poches du
voisin qu’on vide (p. 65)… Et la mise à l’écart des « moricauds » (p.
43), sordide imitation du racisme montré par certains Allemands.
De ces derniers, on ne voit pas le visage, caché par une casquette ou un
casque. On n’entend que les ordres, les menaces. On ne voit que la
brutalité, les coups qui pleuvent sur le petit comptable qui décide de
s’arrêter là, et qui s’oppose peut-être pour la première fois de sa vie
(« je ne bougerai pas ! »), ou sur le sous-officier qui proteste contre
le mauvais traitement infligé à un Sénégalais (p. 68 à 71). On mesure
aussi leur cynisme : « Je n’ai rien à faire de la convention de Genève ;
nous avons gagné ; vous avez perdu. Nous commandons, vous obéissez… » ;
« Nous fournissons les morts… Vous, vous les enterrez » (p. 70-71).
Et autour de ces soldats, les civils. On croise ainsi un charroi rempli
de chaises qui remonte vers Roubaix. Des villageois déposent des paniers
de vivres à l’approche de la colonne (p. 40). On en voit qui refuse
d’ouvrir à des évadés, recueillis tout de même par d’autres, sans que
les discriminations soient oubliées pour autant.
Le dessin reste sobre, sans couleurs autre que le noir, et il est
très soigné. Le décor n’est pas présent dans toutes les planches :
l’attention du lecteur est concentrée sur les hommes. Ne manquent
peut-être que les débris matériels des armées en déroute, les ruines,
qui auraient pu alors accentuer le sentiment de déconfiture.
De la même façon, Pascal Rabaté ne verse pas dans la facilité d’une
langue anachronique. Il a puisé à des bonnes sources littéraires et
autobiographiques (p.118). On est étonné de ne pas lire le nom de
Jacques Perret et de son Caporal épinglé (Gallimard, 1947),
notamment pour les planches qui traitent des tentatives d’évasion. Mais
on retrouve bien Robert Merle et son Week-end à Zuydcoote
(Gallimard, 1949), en particulier pour l’épisode de l’accueil des
fuyards. Les paroles échangées rappellent les propos que les
protagonistes de ces deux ouvrages (mis en scène au cinéma un peu plus
tard) pouvaient d’échanger, avec la même verve et la même truculence
(comme on a pu le lire avec les citations plus haut) qui aident à
comprendre ce que les hommes ressentent réellement, sans détours, dans
une langue simple, mais franche.
La situation rappelle également les deux volumes que Jacques Tardi [1] a consacré à son père, engagé lui aussi dans la campagne de France, prisonnier, et qui a erré dans une Allemagne en ruines. Une relecture de ces albums s’avère tout à fait opportune.
Notes
[1] Jacques Tardi, Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, Casterman
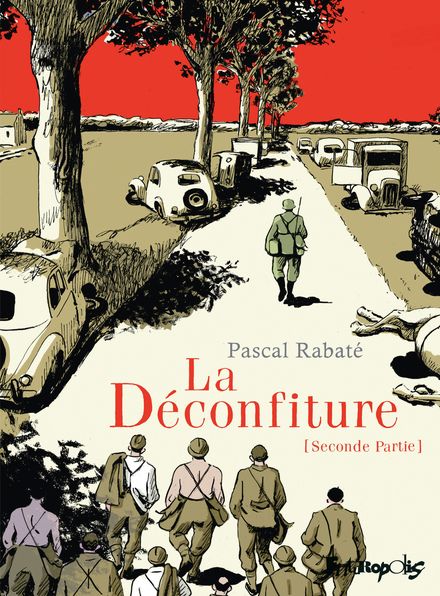



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de me faire part de vos remarques…